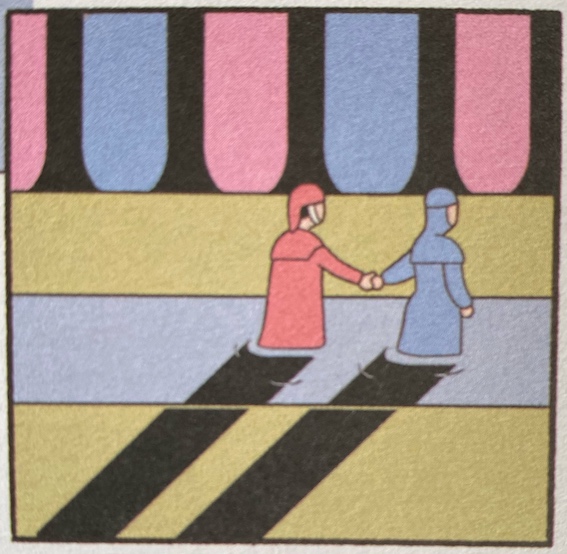Le Purgatoire des poètes, par Marco Martinelli et Ermanna Montanari
Le Purgatoire des poètes présenté le 11 décembre 2024 à l’Institut Culturel Italien de Paris est un spectacle original et spectaculaire. Il réunissait autour de Marco Martinelli et d’Ermanna Montanari, cofondateurs du Teatro delle Albe une trentaine d’actrices et d’acteurs amateurs qui ont fait vivre le temps d’une soirée la poésie de Dante Alighieri.

Les acteurs ayant participé à l’«action chorale», Le Purgatoire des poètes, à l’Institut Culturel Italien de Paris, le 11 décembre 2024. Photo: Marc Mentré
Marco Martinelli a déjà planté la tente de son Teatro delle Albe sous toutes les latitudes et sous tous les continents, en Europe, aux États–Unis, à New York et Philadelphie, en Amérique latine, à Buenos Aires, en Afrique au cœur de Kibera un bidonville de Nairobi, la capitale du Kenya…
Ce 11 décembre 2024, c’est sous les ors du grand salon de l’Hôtel de Galliffet, qui abrite l’Institut Culturel Italien de Paris, qu’il s’est installé avec Ermanna Montanari, avec qui il a cofondé le Teatro delle Albe. Ils ont recruté une troupe d’une trentaine d’acteurs et d’actrices amateur(e)s avec lesquels ils ont préparé l’azione corale de ce soir, un spectacle qui accorde une grande part à l’improvisation.
Nous sommes tous cet «everyman»
Purgatorio dei poeti ne ressemble en rien à un spectacle théâtral classique et d’abord par la disposition du lieu: une large estrade barre le fond de la salle et fait office de scène improvisée, tandis que les chaises des spectateurs sont disposées en un ovale qui libère un large espace où peuvent circuler librement les acteurs.
Pour reprendre le titre d’un livre qu’a écrit Marco Martinelli, c’est au nom de Dante1 que se déroule cette soirée en quatre actes.
Le premier acte nous amène au début du Chant I, dans cette selva oscura où Dante est perdu. Mais dit Marco Martinelli, ce n’est pas le seul Dante qui est égaré, c’est en fait chacun de nous qui l’est; égaré non pas seulement dans une forêt sombre mais perdu dans sa vie. Il est —nous sommes— cet “everyman” dont parlait Ezra Pound.
Pour mieux faire résonner les douze premiers vers de ce premier Chant, Marco Martinelli ressuscite le théâtre grec de Sophocle ou d’Eschyle avec son chœur —«qui est le peuple grec», dit-il— et son coryphée qui le dirige: il lance un vers, et le chœur le répète. La voix de Dante commence alors à revivre.
Mais cela ne suffit pas. Comme cela se faisait autrefois dans les cafés des petites villes des Apennins, où beaucoup «connaissaient par cœur des passages entiers de la Comédie et les récitaient», mais le faisaient, comme lorsque l’on s’est tant approprié en texte ou un poème, en ajoutant un mot, un expression, une phrase… lui aussi va ajouter, un mot, une expression, une phrase, passer du toscan au français, mais aussi inventer une gestuelle. Et comme dans le théâtre grec, les trente acteurs du chœur vont répéter les vers, les phrases, les gestes que leur jette Marco Martinelli dans ce qui devient une chorégraphie magique où le verbe se mêle au geste.
Le chant du souvenir de La Pia
Au cinquième Chant du Purgatoire, Dante rencontre l’âme d’une femme qui lui demande de se souvenir d’elle lorsqu’il sera retourné «dans le monde» des vivants». Les sept vers secs qui ferment ce chant sont parmi les plus poignants et les plus célèbres de la Divine Comédie. L’histoire de la Pia, que «Sienne fit et que Maremme défit»2, est sans doute celle d’un féminicide, mais il résume aussi sans doute aucun les violences faites aux femmes.
C’est de ces violences dont il sera question au deuxième acte. Il a été préparé lors d’un atelier «réservé aux femmes». Il s’agissait pour chacune d’elles de se souvenir d’une phrase, d’une apostrophe dont elles avaient été victimes. Marco Martinelli et Ermanna Montanari à partir de ce matériau brut ont organisé une scénographie
Tout commence donc à partir de ces vers que doucement, presque tendrement, Pia adresse au Dante pèlerin : «quando tu sarai tornato al mondo / e riposato de la lunga via». Mais cette douceur ne dure pas. Les mots durs tombent dru. Les poings se lèvent, les échines se courbent, les injures, les attaques sur le physique —«trop grosse», «trop maigre»— s’enchaînent dans un chœur à la fois grave et douloureux mais libérateur. «Ricorditi di me, che son la Pia». Toutes ce soir-là étaient la Pia, toutes étaient son souvenir.
Le troisième acte fait revenir le spectateur au début de la Divine Comédie, à son deuxième Chant, celui où Dante, ne se sent pas légitime pour poursuivre son chemin dans l’au-delà, car il est dit-il ni Énée, ni saint Paul. Il le fera pourtant car c’est grâce à une chaîne d’amour —Marie, Lucie, Béatrice— que Virgile est venu à son secours. Et cet amour réconforte et porte.
Un spectacle à venir avec 1000 acteurs
Ces doutes, ces hésitations et leur résolution, c’est le chœur des hommes qui va nous le raconter, un chœur où chacun prendra à son tour le rôle du coryphée dans un brassage de corps et de mots qui retrouve la force, la tension et la douceur du premier acte.
«C’est le chant le plus difficile», dit Ermanna Montanari avant de monter sur scène pour lire à voix nue le trente troisième et dernier chant du Paradis, celui qui clôt la Divine Comédie, et qui clôt aussi le spectacle. Mais pour difficile qu’en soit la lecture, il est aussi le plus beau, celui où la foi est la plus pure, celui où la lumière est la plus éblouissante, celui où les mots manquent à Dante pour décrire ce qui relève de l’indicible et de l’ineffable. Puis la page étant refermée et les lumières du spectacle éteintes, il ne reste que «l’amor che move il sole e l’altre stelle»
Cette action chorale n’est pas destinée à rester un spectacle orphelin. On peut même la considérer comme un laboratoire, car l’année prochaine il sera question d’un spectacle mobilisant 1000 acteurs amateurs. Mais de cela nous reparlerons.